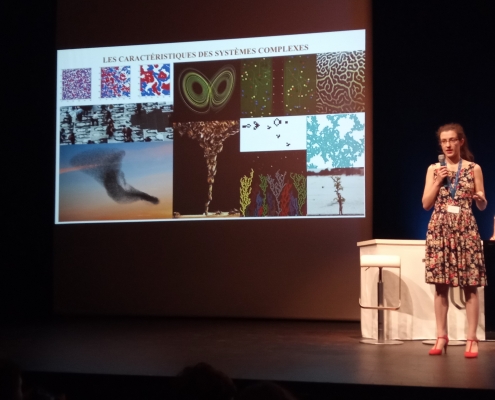L’Incubateur au Forum de NIMS
Le Forum des NIMS, à destination des chercheurs, étudiants et professionnels de la médiation et de la communication scientifique, vise à éclairer les pratiques nouvelles et innovantes en la matière. L’Incubateur était invité à cette 4ème édition, tenu le 13 juin à Grenoble, qui s’intéresse à la médiation par la narration immersive et interactive.
POURQUOI NOS PROJETS SONT INNOVANTS ?
La participation au forum des NIMS a permis aux cinq groupes de l’Incubateur de partager avec les professionnels de la culture scientifique et technique l’avancement de leurs projets de médiation.
Cette journée a également permis aux différents groupes de l’Incubateur de découvrir les autres projets de médiation présentés tout au long de la journée et qui, au même titre de l’Incubateur, utilisent un format immersif et interactif.
Les sciences en jeu vidéo : médiation scientifique et scénarisation, ce que le game design peut nous apprendre
Les médiateurs.trices scientifiques s’intéressent de plus en plus au contenu scientifique dans les jeux vidéos, ces deux derniers interagissent pour un résultat ludique et instructif. Les chercheurs et les professionnels de la culture scientifique et techniques s’accordent à dire qu’on doit accorder plus de place à la scénarisation du jeu.
Pour nous raconter leurs expériences en médiation scientifique via le game design, le forum de NIMS a fait appel, entre autres intervenants, à Raphaël Granier, Directeur de recherche au CNRS, il travaille au laboratoire Leprince-Ringuet de l’École Polytechnique. Raphaël qui est chercheur en physique des particules et écrivain de science fiction, s’intéresse depuis 2014 à la diffusion des sciences par le vecteur vidéoludique.
Dans son laboratoire, Raphaël a développé une activité liée aux jeux vidéo et à la réalité virtuelle et il est convaincu que voir des collisions de particules en réalité virtuelle, en volume, permettra de mieux les appréhender. Il dirige la réalisation d’un premier jeu sur la physique des particules, lancé en 2019 par sa Fondation Cassagnac et l’École polytechnique et financé par Ubisoft.
Quand les jeux vidéos sont mêlés à la science c’est une opportunité pour appréhender cette dernière. Au delà du ludisme présent dans les jeux, le contenu scientifique est primordial et il tend de mieux en mieux à traduire une vérité scientifique. Et c’est dans cette lignée que s’inscrit le projet ComplexCité qui a choisi comme support de médiation un web documentaire interactif qui place l’utilisateur dans un jeu de rôles, lui permettant de visualiser l’évolution du système urbain suite à ses choix d’infrastructures.
Le projet ClimarisK intègre le game design dans leur dispositif de médiation qui propose une application de jeu (sur smartphone et tablette) ludique et instructive, où les joueurs sont amenés à prendre des décisions au niveau local, régional ou global pour limiter le dérèglement climatique en cours, lié aux émission massives de gaz à effet de serre.
Le storytelling scientifique : l’art de raconter de belles histoires… sans raconter les mêmes histoires
Certains schémas narratifs parviennent efficacement à capter notre attention lors de conférences ou à la radio. Mais, la narration existe depuis toujours que certains schémas risquent de devenir récurrents. Pour gagner en pertinence, d’autre formats de narration voient le jour, on entend parler de pitchs rapides mais efficaces comme Ma thèse en 180 secondes dont l’invité Ludovic Lecordier, formateur pour M180 et fondateur de Spontanez-vous, nous a présenté les avantages et les défis. On parle aussi de journalisme scientifique mobile et voyages autour des sciences tel que Science Vagabonde, présenté par Mariana Diaz et Thibaud Sauvageon qui se sont lancés dans un tour du monde afin de rencontrer les différents acteurs du monde des sciences dans toute leur diversité.
Le projet Incubateur Blue DiplomaSEA, se base également sur la construction du discours : le storytelling représente le point en commun entre ces différentes initiatives, et propose des jeux sérieux destinés aux professionnels et au grand public pour porter à connaissance les enjeux de la protection des écosystèmes en Haute-mer où la biodiversité est très riche mais peu protégée. Ce projet de médiation met en lumière l’importance de la négociation de compromis, face à la complexité de la problématique du développement durable et de la gouvernance en haute mer, dans la perspective de la reconnaissance par la communauté internationale de l’océan en tant que bien commun de l’humanité.
Vu d’ailleurs, un éclairage sur les médiations scientifiques : la scénographie immersive
La scénographie immersive est la nouvelle façon de faire, qui se développe de plus en plus en France, pour découvrir les expositions scientifiques et artistiques. Le forum des NIMS a accueilli en début d’après-midi la scénographe Clémence Farrell, de l’Agence Clémence Farrell qui travaille sur plusieurs projets immersifs en France et outre-manche, pour partager avec nous quelques une de ses expériences.
Parmi les travaux d’exposition immersive de Clémence Farrell : L’Historial de Jeanne d’Arc qui a ouvert ses portes à Rouen en 2015. L’Historial n’est pas un musée traditionnel d’objets de collection mais un parcours spectacle qui raconte l’incroyable destinée de l’héroïne avec beaucoup d’émotions en faisant appel à la technologie et à l’innovation.
Et parce qu’une image vaut mille mots, découvrons l’exposition immersive sur l’histoire de la pucelle d’Orléans en images :
Dans nos projets d’Incubateur, deux groupes ont fait le choix de vulgariser les systèmes complexes à travers des expositions interactives qui invitent les visiteurs à s’approprier l’expo et à interagir avec elle.
La Complexité en Question (s) propose au visiteur de découvrir les différentes règles qui régissent les systèmes complexes à travers une exposition participative et interactive conçue sous la forme d’un labyrinthe et basé sur une série de questions faisant référence à des situations familières. L’expo invite le public à expérimenter concrètement ces situations et lui permet de découvrir les caractéristiques qui définissent les systèmes complexes.
A travers un parcours scénarisé dans plusieurs espaces thématiques, groupe Langage complexe comme Bonjour propose “une expo dont vous êtes le héros”. L’exposition proposée par le groupe aborde les différentes facettes du langage, multiéchelle, plurimodal, transculturel et interdisciplinaire considéré comme étant un système complexe au sens scientifique du terme.